











Grace a l’essai “L’emigrante” ecrit par Larissa Fleur femme ecrivaine et femme poete (elle est aussi l’illustrateur de notre revue) vous, cher lecteur, pouvez comprendre pourqoui en France chaque annee on enregistre de 1000 a 1500 mariages entre les Russes et les Fransais. A tous les jeunes maries aussi bien qu’a tous les menages internationaux ayant un grand stage nous souhaitons le bonheure infini dans leur vie familiale
Larissa Fleur
L'Émigrante
ou
Nouvelle vision de la vie
Je me souviendrai de ce jour, sans doute, toute ma vie. En tout cas, je ne doute pas que j'en garderai un souvenir aussi doux et vif que ce soleil lyonnais qui jette un coup d'œil curieux dans ma maison à travers la fenêtre, tel un témoin de ma joie indicible. La lettre que j'attendais durant presque huit mois et à laquelle je rêvais toutes les longues années de mon émigration en France vient tout juste de me parvenir.
J'ouvre l'enveloppe avec émotion. Je lis chaque mot attentivement avec avidité. Comme tout est simple et clair. Mais il semble, que le cerveau ne soit pas encore prêt à recevoir cette information, comme s'il attendait un quelconque piège tout en m'envoyant le signal correspondant. C'est pourquoi, n'en croyant pas mes yeux, je parcours une nouvelle fois les lignes du texte: «Madame, J'ai le plaisir de vous faire savoir que vous êtes Française depuis le 26/07/2010. En effet, votre nom est inscrit dans le décret N°034 portant naturalisation et réintégration, signé à cette date et publié au Journal officiel du 28/07/2010 sous votre nom de naissance... » « Je suis française! », je réalise enfin. « Je suis française! », dis-je en chuchotant soit par crainte, soit par gêne de prononcer cette phrase à la voix haute. C'est compréhensible. Il y a à peine deux minutes j'étais une émigrante russe des plus ordinaires avec toutes les conséquences qui en découlaient: le titre de séjour, le contrat de travail CDD, car les émigrants ne risquent pas de voir un autre contrat leur tomber dessus, le complexe d'infériorité qu'on ose rarement avouer.
Je m'assieds sur le canapé. J'enlève mes escarpins. Comme je me sens bien et légère! Le soleil se frotte à mes jambes tel un chaton jaune et duveteux. Je regarde la lettre, incapable d'en détacher mes yeux. Mon cœur tinte telle une clochette joyeuse. « Je suis fran-çai-se! », je répète la phrase avec déjà plus d'assurance, en chantonnant. Puis j'envoie des SMS à mon mari, à ma fille, j'appelle ma sœur en Russie pour partager avec elle la nouvelle. Heureusement, elle est chez elle. Nous pouvons discuter tranquillement. Je lui lis la traduction russe de la lettre, lentement, comme j'ai l'habitude de lire Pouchkine. Lors d'une lecture rapide, le texte se vide de son harmonie et, avec elle, de la vie des mots palpitants; le texte devient inanimé, comme une feuille desséchée. C'est pourquoi je préfère lire lentement, pour tirer le plaisir de la lecture. J'imagine les mots comme des êtres vivants. Chacun d'eux a son visage, son caractère. Plus encore, ils sont tout aussi aptes que nous à faire toutes sortes de prouesses. Ils peuvent attrister ou combler de joie, nous faire des surprises et même modifier notre vision de la vie. Prenons, par exemple, cette lettre. Il y en a, pour qui ce n'est qu'un papier administratif, mais pour moi les mots « vous êtes Française » me mettent sur le même pied d'égalité que les autres citoyens de France, ce qui, de son côté, me donne une toute nouvelle vision de la vie. Laquelle? Sans doute plus valorisante et plus harmonieuse. Et vous, cher lecteur, ne vous était-il pas déjà arrivé de ressentir quelque chose de ce genre? Je pense que si, et à plusieurs reprises. Prenons l'exemple de l'achat d'un nouveau manteau. L'ayant apporté chez vous, vous l'aviez essayé et vous étiez mis devant un miroir. Quelle joie et quelle chaleur intérieure vous éprouviez alors, n'est-ce pas? Vous aviez redressé vos épaules en essayant de vous tenir droit et déjà vous aviez regardé le monde autrement. Il vous semblait sinon merveilleux, du moins et sans aucun doute transformé. Vos yeux étincelaient de joie. Votre démarche devenait plus assurée et gracieuse. Alors, qu'est-ce qui avait changé? C'est votre vision du monde! Car les choses, les personnes, les mots, les évènements sont les maillons d'une même chaine, capables non seulement de nous apporter une nouvelle vision de la vie, mais aussi un nouveau regard sur nous-mêmes.
Ma sœur capte mon état d'esprit, et je sens qu'elle se réjouit sincèrement de mon bonheur. Il n'y a ni piques lancées avec sarcasme, ni jalousie, comme c'était le cas avec mes collègues à l'école où j'ai travaillé pendant quatorze ans. « Dieu merci! Maintenant tu peux être tranquille. Félicitations! », me dit-elle. Puis nous parlons de maman, de nos enfants, des bobos liés à l'âge, et, tout doucement, notre discussion se reporte sur nos souvenirs, sur la manière dont tout a commencé, sur les circonstances qui m'avaient amenée en France.
Je m'en souviens comme si c'était hier, j'avais trente-cinq ans. C'était en 2001. La nuit commençait à tomber. Ce samedi soir j'étais venue chez Tatiana, mon amie de fac, avec l'intention d'y passer la nuit. Dehors il neigeait. Nous étions assises dans la cuisine, comme c'est souvent de coutume chez les russes, et discutions autours d'un thé. Seulement, Génia n'était pas avec nous. Cela faisait déjà quelques mois qu'elle n'avait donné aucun signe de vie. Elle avait dit qu'elle allait être très occupée et qu'elle allait nous appeler dès qu'elle serait disponible. Nous savions seulement qu'elle n'habitait plus avec son Pacha, maître dans l'art d'embobiner les gens et de leur raconter des histoires, et que, ayant quitté l'école, elle s'était fait embaucher en tant que secrétaire dans une entreprise, car on y était plutôt bien payé. Avec cet argent, on pouvait vivre, s'habiller et même aller au théâtre voir toutes les nouvelles mises en scène, ce dont moi et Tatiana ne pouvions que rêver, car nous ne pouvions pas concevoir d'abandonner l'enseignement, et c'est pourquoi nous continuions à travailler, moi à l'école, elle à l'université, avec pour seul moteur l'enthousiasme. Nous étions sérieusement inquiètes de la disparition de notre amie. Ce soir nous ne parlions que d'elle, car, toutes les trois, nous avions par avance convenu de ce rendez-vous. Nous pensions d'abord qu'elle était tombée folle amoureuse d'un quelconque homme d'affaires de passage en ville, et qu'elle était en train de filer le parfait amour avec lui. Puis nous avions eu l'idée d'une opération de chirurgie plastique.
Soudain le téléphone s'était mis à sonner. Tania avait décroché le combiné. La voix joyeuse de Génia nous avait salué et souhaité bonnes fêtes (Noël et Nouvel An). Nous l'avions aussi saluée et nous étions agglutinées au combiné en patientant stoïquement le temps d'une pause.
- Les filles, je me suis mariée! nous avait abasourdies Génia avec la nouvelle.
- Quand? Avec qui? Pourquoi sans rien dire à personne? avaient jailli nos questions.
- Ne me faites pas la tête, s'il vous plaît! Je ne suis pas en Russie actuellement. Je suis en France. Je ne peux pas parler longtemps. Je vous écrirai tous dans une lettre. D'accord?
- Génia, attends! Comment t'es-tu retrouvée là-bas? Dans quelle langue parles-tu à ton mari? poursuivions nous, sachant qu'à l'université elle avait étudié l'allemand et le tchèque, alors que moi et Tatiana avions appris l'anglais et le polonais.
- En français, bien entendu, nous avait-elle stupéfaites.
- Et quand donc l'as-tu appris? avais-je dit machinalement et à brûle-pourpoint dans le combiné.
- Avant mon départ, les filles. Durant tout l'automne j'assimilais la langue et apprenais la conduite pour arriver avec mon permis et, une fois sur place, ne pas me prendre la tête avec cette question.
- Ça alors, Génia! Tout fait en douce! Motus et bouche cousue! nous étions-nous ruées sur elle.
- Vous auriez pu me féliciter au moins, avait-elle dit un peu vexée.
- Oh! Génia! Mais bien sûr! Nos félicitations pour le mariage! Vivez heureux, toi et ton mari! avions-nous débité à toute vitesse la première chose qui nous était venue à l'esprit, car nous n'avions pas encore réalisé le caractère réel de ce qui se passait.
- Merci les filles! nous avait-elle répondu.
- Il t'aime au moins? Il est beau? Il n'est pas chauve? T'aide-t-il à la maison? Et l'argent, il t'en donne? avaient à nouveau fusé nos questions.
- Allez! A plus mes jolies. Je vous écrirai dès demain. Attendez ma lettre avec les photos.
- A plus. Sois heureuse! avions-nous eu le temps de dire avant que ne retentisse la sonnerie, ainsi nous séparant.
Inutile de vous dire que moi et Tatiana étions tout simplement sonnées. Personne ne pouvait ne serait-ce que penser que notre sage Génia allait partir en France et s'y marier, que les retrouvailles chaleureuses de notre trio dans la cuisine allaient se transformer en duo.
Durant la nuit moi et Tania n'arrivions pas à dormir. Dehors il neigeait. Le vent grondait dans la cheminée, comme s'il était vexé qu'on ne laisse pas entrer pour se réchauffer. Les souris grattaient doucement les murs sous le papier-peint, visiblement souffrant, eux aussi, d'insomnie. Nous avions allumé la veilleuse et nous étions assises sur le canapé dans le séjour nous couvrant les jambes avec un plaid. Nous avions discuté ainsi pratiquement jusqu'à quatre heures du matin, jusqu'à ce que le sommeil nous emporte.
Quelques semaines s'étaient écoulées. Dès la réception de la lettre de Génia, Tania m'en avait informée. Nous nous étions retrouvées. La lettre faisait comprendre que Génia était heureuse avec son Nöel. Sur la photo qu'elle nous avait envoyée nous avions vu un jeune couple heureux et des invités du côté du marié qui étaient présents à leur mariage. De plus, elle avait écrit sur sa vie en France, sur ce qu'elle avait découvert durant les premiers mois passés dans le pays, sur ses nouvelles connaissances parmi les anciens émigrés russes. La lettre respirait une nouvelle vie à laquelle nous rêvions aussi en secret.
C'est cette lettre, à proprement parler, qui avait marqué pour moi le point de départ d'une nouvelle étape dans ma vie. En rentrant chez moi, dans ma petite ville de province, j'avais passé ma vie au crible et étais arrivée à une conclusion peu réconfortante: plus rien de bon ne m'attendait en Russie. Car tous les hommes convenables étaient déjà casés, et la perspective d'être une éternelle maîtresse ne me séduisait pas vraiment.
J'avais derrière moi un divorce et un enfant dont je devais prendre soin. A l'école on nous payait un salaire de misère, bien que j'aie été à l'époque professeur de catégorie supérieure. Encore durant la présidence de Eltsin, j'avais eu mon CAP coiffure après avoir suivi les cours du soir, alors je me faisais un peu d'argent pendant mon temps libre: je coupais les cheveux de mes connaissances, je les coiffais en complétant ainsi mon budget. La présidence de Poutine était prometteuse mais n'offrait pas plus d'espoirs. Après le désordre de la période de Eltsine, un semblant d'ordre s'établissait dans le pays. Il n'y avait plus de retard dans le versement des salaires, il y avait plein de vêtements et de produits importés d'Europe, d'Amérique, de Turquie et de Chine dans les magasins et aux marchés. Seulement, les lois ne marchaient toujours pas, et les fonctionnaires, tout comme à l'époque du communisme, prenaient les citoyens pour des idiots. Beaucoup d'entre nous continuaient à vivre grâce à leur espoir des temps meilleurs. Mais est-ce qu'une personne normalement constituée et portant sur soi un regard adéquat pourrait vivre des simples promesses? N'aimerait-elle pas être heureuse maintenant, à l'instant même et non dans un futur lointain? Et qui sait si nous vivrions suffisamment longtemps pour l'atteindre, sachant que l'espérance de vie en Russie est bien inférieure à celle en Europe? Car nous passons toute notre vie à lutter et à faire du « forcing », à parcourir des instances, à collecter un nombre incalculable de papiers pour résoudre un seul petit problème, tout cela en se faisant sans arrêt humilier par la cohorte des fonctionnaires et par les représentants du pouvoir à tous les niveaux.
Moi aussi, j'ai goûté à cet immense « plaisir ». Au tout début de ma carrière d'enseignante j'ai dû par deux fois me battre pour mon appartement, car moi, mon mari et ma fille habitions alors chez ma mère dans sa maison minuscule, sur les dix-neuf mètres carrés. Le logement constituait alors un vrai problème dans tout le pays. Les appartements d'État étaient accordés par piston, en incluant ses connaissances dans les bonnes listes. J'avais simplement eu de la chance, car j'étais une jeune spécialiste et l'école était intéressée par moi. Au bout de trois ans d'allées et venues à des bureaux et à des conseils de toutes sortes de commissions, j'avais obtenu un bon d'appartement tant attendu pour une chambre de vingt-neuf mètres carrés dans un logement communautaire, mais nous n'étions pas destinés à y emménager. Il était habité depuis quelques mois déjà par une jeune femme avec un nourrisson. Elle n'avais pas perdu de temps à aller et venir en commissions et dans des cabinets, elle avait simplement forcé les serrures. Ce qui intrigue, c'est que même après un procès personne n'avait osé la déloger. Elle avait gardé la chambre. Je ne pouvais pas suivre son exemple. Ainsi, les six mois suivants étaient passés dans le « forcing » et l'attente. Au final, on m'avait attribué une autre chambre de superficie deux fois inférieure à la précédente en disant: « Vivez ici un moment, et ensuite vous aurez un bon appartement ». C'est pendant dix ans que j'y avais vécu avec ma fille. Puis, à l'époque de la perestroïka, on avait pu connaître toutes les joies du système de rationnement, lorsque les magasins s'étaient soudain vidés et les produits ne pouvaient être obtenus qu'en échange de coupons et de talons. A l'époque de l'établissement du « capitalisme sauvage », dans les années quatre-vingt-dix pleins de fougue, quand le salaire était versé tantôt en tissu, tantôt en cercueils au lieu du véritable argent, il a fallu forcer la main au tribunal pour récupérer mes arriérés de salaire qui était gelé pendant trois voire quatre mois pour les enseignants et les médecins de notre petite ville. Où pouvait-on déposer nos plaintes? A qui pouvait-on écrire? Le résultat était le même. D'une façon ou d'une autre, il avait fallu survivre, patienter, essuyer des humiliations, parce que c'était notre Patrie que nous aimions et que nous ne songions même pas quitter, tout comme dans l'enfance nous ne pensions pas quitter notre mère, notre famille, nos amis.
J'écrivais à Génia, en France, à propos de mon quotidien, et elle m'écrivait à propos du sien. Je ne me gênais pas de la presser de questions et, sans omettre une seule d'entre elles, elle me répondait avec cette droiture et sincérité propres aux vieilles amies. Parfois elle me grondait un peu et m'enseignait la vie en me donnant ses sages conseils. Parce qu'en étant à l'étranger, elle avait ouvert les yeux et avait le droit de juger avec sévérité la réalité russe ainsi que ma vie.
En mai 2002, une invitation de la part de Génia m'était parvenue. A cette époque elle était déjà devenue mère d'un fils tant attendu, son premier. J'avais dû préparer mon voyage à l'avance: me faire faire un passeport, mettre l'argent de côté pour les billets et des petits achats, lire la littérature nécessaire, me faire faire un visa, acheter des cadeaux. C'était mon premier voyage à l'étranger, ce qui le rendait inquiétant et joyeux.
Depuis Moscou, j'allais à Paris en car à travers l'Europe du Nord. Puis, après quelques petites péripéties, j'avais pris un train qui m'avait conduite chez Génia en Bretagne. Enfin nous nous étions retrouvées. Et ce n'était pas un rêve. La maison vaste et accueillante de Génia et Nöel, meublée dans le souci du bonheur familial, m'avait tout de suite plu. On se sentait léger dans leur agréable compagnie. Je ne maîtrisais alors pas encore la langue et Génia me servait de traductrice. J'avais visité beaucoup d'endroits intéressants avec les amis de Génia, et j'avais compilé deux albums photo. La France m'avait séduite. Le premier mot français que j'avais appris était « magnifique ». Je le répétais inlassablement sur la côte du Golfe de Gascogne et celle de La Manche, à Quimper et à Vannes, à Mont St-Michel et à Pontivy, et Dieu sait où encore.
Les trente jours étaient passés vite, et moi, remplie de vives impressions sur la France, j'avais regagné ma Patrie. Descendue du car, j'avais posé un regard nouveau et non voilé sur ma petite ville de province avec ses bas-côtés de la route couverts de mauvaises herbes, avec son herbe grise de poussière, avec ses nids de poule rassemblant à des tranchées et des fondrières comme si la guerre n'était pas encore terminée, avec ses petites maisons grises et penchées du secteur privé et avec ses flaques d'eau croupie grandes comme un lac devant des immeubles d'habitation. Le contraste avec la France était si flagrant que les larmes m'était montées aux yeux.
« A quel point doit-on ne pas aimer son peuple pour l'abandonner à son sort et s'occuper à se remplir les poches et les comptes en banque. Mais que dis-je? Est-ce qu'un jour c'était différent? Rien que des discours creux et des excuses. Qui sommes-nous pour eux? De la poussière sur la route! De la boue qui colle aux godasses! Ils n'en ont absolument rien à faire de nous. De l'autre côté du pont, ils possèdent des villas entourées de haute clôture, ils ne marchent pas sur ces routes et n'empruntent pas les véhicules déglingués des transports en commun. Ils ont leur vie à eux. Ils n'ont besoin de nous que les jours des élections pour rassembler des voix et pour l'effet de façade, comme quoi, chez nous aussi c'est de la démocratie », pensais-je sur le chemin de la maison de notre maire, notre gouverneur et des autorités qui leur sont supérieures.
Ma fille m'attendait avec impatience chez sa grand-mère. Nous avions eu le temps de nous ennuyer l'une sans l'autre. Je lui avais emmené autant de cadeaux qu'elle n'en avait jamais reçu de toute sa vie. Ensuite avaient suivi les retrouvailles avec ma famille et mes amies, mes collègues. A la réunion familiale, le récit de mon voyage avait été écouté avec attention, et lorsque j'avais fait part de ma décision d'émigrer dans un ou deux ans, personne ne m'avait crue. On croyait que c'étaient des « rêves-projections », comme aimait s'exprimer ma sœur, qui ne sont pas destinés à se réaliser.
En un an, tout comme Génia, j'avais appris à conduire et avais eu mon permis B à l'issue des examens. J'avais commencé à apprendre la langue. J'allais jusqu'au chef-lieu de la région, car dans notre ville les professeurs de français étaient très rares. En hiver, le dernier jour de janvier, j'avais reçu une lettre d'un français avec lequel nous avions entamé une correspondance sérieuse. A cette époque je pouvais déjà composer de petites lettres, mais je n'avais pas d'ordinateur, il me fallait me rendre à la poste du chef-lieu de la région et envoyer mes e-mails depuis là-bas, puis y revenir chercher la réponse. L'allée-retour prenait deux heures. Mais il n'y avait pas le choix. Envoyer le courrier par voie postale n'était pas raisonnable. Notre correspondance s'était prolongée jusqu'en été.
En juin 2003 j'avais pris la route pour Lyon. Mon ami était accueillant. Il m'avait montré la Méditerranée et le Lac du Bourget, m'avait présenté son fils et ses amis et m'avait épaté par les plats que lui-même préparait. En un mot, il me charmait par tous les moyens à sa disposition. Son appartement se situait dans une banlieue lyonnaise, près du métro et d'un grand parc. Nous étions à plusieurs reprises sortis nous promener dans le centre-ville et le Vieux Lyon. Les soirs j'appelais Génia avec la permission de mon ami et je partageais avec elle mes impressions. Malheureusement je n'avais pas pu aller en Bretagne.
Mon ami se comportait avec dignité, ne m'incitait pas à aller plus loin et était même timide quelque part. C'était peut-être le résultat du fait qu'il avait un an de moins que moi. Ou peut-être qu'il voulait montrer qu'il n'était pas comme les autres. Je ne sais pas. Nous avions dormis dans les chambres séparées jusqu'à mon départ. Nous nous sommes quittés en amis, sans baisers ni étreintes. Je lui étais reconnaissante pour ce voyage. Nous n'avions pas dit un mot tout au long de la route de sa maison jusqu'à la gare. Et une fois à la gare, il avait éclaté en sanglots, ce qui m'avait étonnée tout autant que lui. Je repartais pleine de vives impressions tout comme lors de mon voyage précédent, bien que sans espoir de poursuivre cette relation. Une fois chez moi, quand on me questionnait sur le voyage et le « fiancé », je disais que je ne lui avais pas plu. « Ne sois pas triste, t'en trouveras un autre. Si ce n'est pas Piotr[1], alors ce sera Fiodr », me disait ma sœur.
Finalement, en automne il m'avait demandé en mariage dans une lettre qu'il avait envoyée par la poste. J'étais agréablement surprise. Ensuite, j'avais reçu son invitation. Le 1er janvier moi et ma fille étions à Paris. Le mariage avait eu lieu le 31 janvier 2004. Tout était modeste, sans grand festin, sans chansons ni danses, sans cadeaux. Toutefois, nous avions reçu des cartes de la part de sa famille proche. Bientôt j'avais intégré les cours de la langue française et parallèlement j'avais commencé à donner des cours de la langue russe aux volontaires qui avaient répondu à mon annonce dans un journal. Quelquefois, mon mari me donnait 10 euros pour les timbres postales. La question de l'argent dans le foyer était très problématique. Je pense qu'il est inutile de faire un dessin de ce que pouvait alors ressentir une femme russe. La France ce n'était pas la Russie où le mari remettait son salaire à sa femme. Dans ces conditions, j'étais forcée à chercher n'importe quelle source de revenu. Ma fille était scolarisée dans un collège, il fallait payer pour la cantine et les fournitures scolaires, il fallait s'habiller.
Nos enfants avaient vite trouvé un terrain d'entente et c'était un grand avantage. Seulement, la relations conjugale entre moi et mon mari ne s'arrangeait pas. Ne parlons pas ici des responsables et de leur degré de culpabilité. Je dirai seulement que je n'ai pas réussi à vivre selon le principe « ce qui s'endurera finira par plaire »[2]. Et vivre comme deux voisins devenait pesant.
C'est une chance qu'au moment du divorce je m'étais déjà adaptée, avais validé mon diplôme et avais un travail. Louer un appartement n'avait pas été difficile. Avec mon ex-mari, nous étions venus ensemble au divorce et avions le même avocat en commun. On nous avait divorcés en cinq minutes. Nous nous étions séparés en amis. D'ailleurs, ma fille passe toujours chez eux pour les fêtes « de famille ». Parfois nous nous appelons, échangeons de nouvelles.
Peu de temps s'était écoulé après notre rupture lorsque j'avais rencontré mon amour. Il était arrivé de façon inattendue, comme envoyé par le ciel en guise de récompense. Nous nous étions mariés. Moi et mon mari Thomas prenions soin de notre bonheur familial, c'est pourquoi les disputes et les scandales n'avaient pas leur place dans notre ménage. Pour une totale harmonie il ne me manquait plus qu'une chose: devenir un membre à part entière de la société française. Cela a eu lieu aujourd'hui. Je vis dans un pays qui prend soin de ses citoyens, qui est devenu ma deuxième Patrie en me prenant sous son aile, en m'hébergeant, comme une mère.
Après la conversation avec ma sœur, je me suis approchée de la fenêtre et j'ai vu la voiture de mon mari. Il venait d'arriver près de la maison. En me voyant, il m'a fait signe de la main, puis il a sorti son sac et un colis. J'ai pensé: « C'est sans doute un cadeau! » et je me suis précipitée pour l'accueillir.
France. Bron. 2010.
Auteur: Larissa Fleur.
Traductrice: Anastasiya Ahkadova.





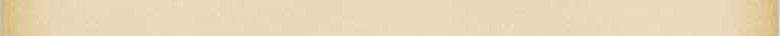

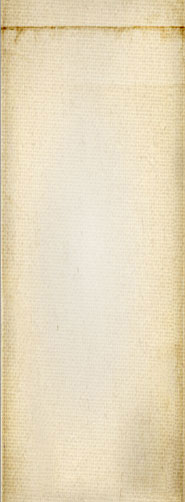

Новые комментарии